Que le prochain tube interplanétaire soit nord-coréen. Que Berlusconi se mette enfin sérieusement à la chanson. Qu’on crée dans la petite ville de Tulkarem un opéra israélo-palestinien. Que l’érythréo-éthiopienne ne soit plus une guerre mais la danse de l’été. Qu’autour des ruines de Bamiyan, un public mixte applaudisse la première comédie musicale afghane d’après guerre. Qu’en matière d’Europe, la culture réussisse là où a échoué l’économie. Que l’Armée du Salut gagne l’Eurovision et force les Conservatoires à jouer dans la rue. Que l’art subventionné s’ouvre à l’art amateur, et vice-versa. Qu’on file le Goncourt au prochain Joël Dicker. Que les liseuses électroniques épargnent les derniers bons libraires et les rares diffuseurs décents. Qu’on distribue gratuitement dans les gares quelques pages de Catherine Safonoff, Jacques Chessex, Corinne Desarzens ou Charles-Albert Cingria. Et surtout, surtout : qu’il fasse beau à Paléo.
Textes chroniques - Page 12
-
Voeux "culturels" pour 2013
-
Joyeux vingtième anniversaire, Europe mort-née !
On évoque souvent le 6 décembre 1992 en des termes strictement politiques et économiques : on pèse les bénéfices, on évalue les pertes. Mais qu’en est-il de la «mentalité» que traduit ce vote? A la mémoire des 49,7% de Suisses qui avaient voté oui ce dimanche dit «noir», laissons la parole à Charles-Ferdinand Ramuz et Max Frisch.
Histoire de nous souvenir que tous les cantons romands avaient alors (à tort ou à raison) voulu monter dans le train européen (les Vaudois à 78,3%), imaginons l’échange d’un Suisse romand et d’un Suisse allemand, deux hommes qui ont su vivre «à l’étranger», le premier à Paris et le second à Rome.
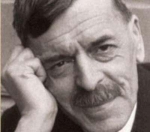 Patriote mais pas nationaliste, Charles-Ferdinand Ramuz a toujours placé la région au dessus de la nation (et l’Europe est une région !). Il nous aurait certainement mis en garde contre un trop frileux repli sur nos frontières : «l’être trop isolé est un être malade. L’être qui ne communique pas est un être condamné. Nous sommes un pays de neurasthéniques et qui ne veulent pas le voir ».
Patriote mais pas nationaliste, Charles-Ferdinand Ramuz a toujours placé la région au dessus de la nation (et l’Europe est une région !). Il nous aurait certainement mis en garde contre un trop frileux repli sur nos frontières : «l’être trop isolé est un être malade. L’être qui ne communique pas est un être condamné. Nous sommes un pays de neurasthéniques et qui ne veulent pas le voir ».Le programme politique de Ramuz aurait surpris bon nombre de ses admirateurs invétérés : « gouverner, c’est distinguer de loin où il serait désirable d’aller et distinguer ensuite comment on peut y atteindre ; ce qui suppose d’abord la possibilité de se déplacer politiquement, économiquement et socialement, on veut dire à l’extérieur comme à l’intérieur de l’Etat. Or c’est précisément cette possibilité que nous n’avons pas ; car encore nous sommes neutres ».
 Sûr que Max Frisch (décédé un an avant le vote) n’aurait pas non plus entendu ce choix comme une preuve d’indépendance : « on ne peut pas parler de liberté avec ces Suisses, tout simplement parce qu’ils ne supportent pas qu’on la mette en doute, cette liberté, qu’on la considère comme un problème et non comme un monopole de la Suisse. D’ailleurs, toute question franchement posée leur fait peur ; ils ne pensent jamais au-delà de ce qui leur assure une réponse toute prête, une réponse pratique, une réponse qui leur soit utile. »
Sûr que Max Frisch (décédé un an avant le vote) n’aurait pas non plus entendu ce choix comme une preuve d’indépendance : « on ne peut pas parler de liberté avec ces Suisses, tout simplement parce qu’ils ne supportent pas qu’on la mette en doute, cette liberté, qu’on la considère comme un problème et non comme un monopole de la Suisse. D’ailleurs, toute question franchement posée leur fait peur ; ils ne pensent jamais au-delà de ce qui leur assure une réponse toute prête, une réponse pratique, une réponse qui leur soit utile. »Si nombreux sont ceux qui saluent aujourd’hui un vote courageux, l’écrivain zurichois y aurait davantage vu les symptômes d’une angoisse viscérale : « leur peur de l’avenir, leur peur d’être pauvres un jour peut-être, leur peur de la vie, leur peur de mourir sans assurance-vie, leur peur tous azimuts, leur peur de voir le monde se transformer, leur peur quasi panique devant l’aventure intellectuelle ».
Charles-Ferdinand et Max, revenez quand vous voulez !
Le 6 décembre 1992, la Suisse refusait à 50,3% le Traité sur l’Espace économique européen / Max Frisch, Stiller, 1954. C.-F. Ramuz, Besoin de grandeur, 1937.
-
Bienvenus chez moi !
Quand je suis allé à Dogubayazit, dernier village turc sur la route de l’Iran, Murat m’a présenté ses amis, appris des rengaines du parti travailliste kurde et des rondes très festives.Quand j’ai voulu voir ce qu’il restait des bouddhas de Bamiyan, un médecin pachtoune m’a hébergé pour la nuit, et le lendemain, invité à l’accompagner jusqu’au dispensaire de Dara Sadaat.Quand j’ai fait escale à Tioumen, en Sibérie, un cheminot prénommé Serguei m’a accueilli dans son dortoir, au huitième étage de la gare, pour partager des patates, du lard et des chansons de Vyssotski.Quand, randonnant dans le Yunan chinois, j’arrivais au village de Cizhong, un instituteur à la retraite m’a fait goûter son vin rouge (une réminiscence des missionnaires français), puis dévoilé sur mon carnet ses talents de calligraphe.Quand j’errais près de la mosquée du Pacha, dans le quartier de Sidi el-Houari, à Oran, ce bon Saïd m’a emmené en voiture au sommet du djebel Murdjadjo pour me montrer la basilique Notre-Dame-du-Salut, avant de me ramener chez lui pour le couscous du vendredi.Quand, dans les rues d’Alep, je cherchais un endroit pour voir la demi-finale du précédent Euro, des Syriens m’ont convié à une partie de foot le lendemain matin.En chemin pour Shashamané, en Ethiopie, un cycliste s’est arrêté et m’a conduit sur son porte-bagage jusqu’à sa maison, où sa plus petite sœur m’a lavé les pieds (c’est la tradition) ; sa famille a sacrifié une pastèque en mon honneur.Quand je faisais du stop en Espagne, un camionneur roumain venu acheminer une vingtaine de tonnes de papier s’est arrêté ; dans sa cabine, c’était l’hospitalité des Carpates : tu fumes ? tiens, prends ! tu aimes le chorizo ? allez, mange !Etc.Etc. Quand ils sont venus à Morges, dans ma ville natale, je les ai logés dans un bâtiment communal, près de la Préfecture, au Tulipier, un ancien centre de «semi-détention» converti en centre d’accueil pour requérants d’asile déboutés.Ils passeront ainsi la nuit, en compagnie d’un surveillant et d’un agent de sécurité. Demain, ils quitteront les lieux avant 9 heures du matin, ordre de police, pour errer dans les rues jusqu’au soir, avec tout leur barda sur le dos, puisque je préfère qu’ils aient ni armoire personnelle, ni lit fixe : « mes amis, c’est pour votre bien, sauvez-vous au plus vite »...Moi non plus, je ne vais pas bien dormir cette nuit
Quand ils sont venus à Morges, dans ma ville natale, je les ai logés dans un bâtiment communal, près de la Préfecture, au Tulipier, un ancien centre de «semi-détention» converti en centre d’accueil pour requérants d’asile déboutés.Ils passeront ainsi la nuit, en compagnie d’un surveillant et d’un agent de sécurité. Demain, ils quitteront les lieux avant 9 heures du matin, ordre de police, pour errer dans les rues jusqu’au soir, avec tout leur barda sur le dos, puisque je préfère qu’ils aient ni armoire personnelle, ni lit fixe : « mes amis, c’est pour votre bien, sauvez-vous au plus vite »...Moi non plus, je ne vais pas bien dormir cette nuit -
Expédiez vos impôts à Monsanto !
Soyez conséquents et solidaires : investissez l’équivalant de vos impôts dans le développement durable des pays pillés par la multinationale Monsanto, et laissez cette dernière régler votre imposition. Pourquoi ?Parce que Monsanto, numéro un mondial des semences génétiquement modifiées, à l’origine des 90% de la production mondiale, a établi à Morges son siège pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique… même si le peuple suisse a exprimé à plusieurs reprises son opposition à la production d’OGM dans le domaine agro-alimentaire.Parce que cette multinationale américaine génère des dizaines de milliards de bénéfices dans une quarantaine de pays grâce à des pratiques pour le moins discutables : entre autres, dans les pays pauvres, par la vente de graines ne pouvant être semées à nouveau, contraignant les paysans à s’endetter pour en racheter chaque année, faisant d’eux des assistés plutôt que des producteurs. Monsanto contrôle ainsi l’agriculture de ces pays - majoritairement destinée à l’exportation - et rapatrie tranquillement ses bénéfices.Aussi parce que la multinationale est une multirécidiviste, souvent impliquée dans des scandales sanitaires, des pollutions massives, des intoxications de personnes, des publicités mensongères, etc.Surtout parce qu’en 2004, Monsanto a bénéficié d’une exonération fiscale de dix ans sur l’impôt fédéral direct (50%), sur l’impôt cantonal et communal (100 %). Un cadeau qui sera renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, jusqu’en 2018.Cela, alors qu’il s’agit d’une entreprise « boîte aux lettres » qui ne profite pas à l’économie de la région, n’ayant aucune chaîne de production à Morges.Enfin parce que, si le canton a généreusement accueilli ces bourreaux de l’agriculture des pays sous-développés, il peine à accorder la même hospitalité aux victimes de ce type de multinationales, ceux qui ont fait le voyage jusqu’en Europe pour espérer une vie plus digne…
Pour toutes ces raisons, une solution : exonérez-vous d’impôts, convertissez-les en microcrédits destinés au réveil des pays sous-développés, et envoyez une facture équivalente à :
Monsanto International Sàrlrue des Vignerons 1A1110 Morges. -
Je travaille donc je suisse !
Obéissant à son esprit patriote davantage qu’à sa morale travailleuse, le peuple suisse avait su s’offrir, en 1994, un jour de congé tous les 1er août. Mais sinon...
1958 : NON à la semaine des 44 heures.
1976 : NON à la semaine des 40 heures.
1985 : NON aux 4 semaines de congés payés.
1988 : NON à une «réduction de la durée du travail».
2002 : NON à une «durée de travail réduite».
2012 : NON à 6 semaines de vacances payées…
Pourquoi un tel acharnement ?
 Est-ce le propre de l’homo consumericus ? Puisque les vacances ne lui vident plus seulement la tête, mais surtout le porte-monnaie, pourquoi obtenir plus de temps libre s’il n’a pas les moyens de l’«investir»!
Est-ce le propre de l’homo consumericus ? Puisque les vacances ne lui vident plus seulement la tête, mais surtout le porte-monnaie, pourquoi obtenir plus de temps libre s’il n’a pas les moyens de l’«investir»!Est-ce des relents calvinistes ? «Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas», disait ce brave Paul dans l’une de ses épîtres ; car c’est écrit, Dieu déteste les tire-au-flanc, le turbin est une action de grâce, et l’épargne, une rédemption !
Est-ce dû à la suridentification professionnelle ? Car chez nous, le travailleur partiel est suspect, celui qui promène son gosse une matinée de semaine est un chômeur, et ce dernier, un vaurien!
Et si la cause était plus simple ? Si les Suisses ne savaient tout simplement plus que faire de davantage de temps libre ? Comme un vertige, la peur du vide, la privation de la seule activité qui leur reste...
Il faudrait comprendre enfin que le temps libre n’est pas un temps creux, une vacance (du latin «vacare», être vide) ou un sea, sex & sun végétatif. Le temps libre amène certes délassement et divertissement, mais surtout développement personnel.
Dans l'Antiquité grecque, le travail était dévalorisé, considéré comme une activité propre aux esclaves. C’était le temps libre - la skholè (signifiant aussi «école») - qui était noble. Non dépourvu d’abnégation et de persévérance, il permettait de se libérer des urgences du monde pour se consacrer avec lucidité à un travail émancipateur.
Imaginez qu’on ne travaille plus seulement pour s’offrir un beau cadre de vie (dont on ne prend le temps de profiter), une résidence secondaire (qu’on n’habite qu’une semaine par an). Imaginez qu’on lève le pied un peu avant l’EMS, ce dernier club de vacances…
Mais rassurez-vous, si vous avez lu cela jusqu’ici, c’est que vous n’êtes pas étranger à la skholè des Grecs anciens et avez de bonnes chances qu’on n’écrive pas sur votre tombe, comme tout bon Suisse : «le travail fut sa vie».
Le 11 mars, le peuple suisse a refusé (66,5%) l'initiative "6 semaines de vacances pour tous".
-
Un livre, ça n’a pas de prix !
Quand je fais mes courses chez le «géant orange», j’échoue immanquablement sur une petite cinquantaine de livres, des «meilleures ventes» aux prix cassés ; si le magasinier sait où se trouvent le rayon «livre», il ignore tout du contenu.
 Quand je fais mes paiements chez le «géant jaune», je prend un ticket d’attente, soupire, puis ouvre au hasard cette même petite cinquantaine de livres à gros tirages (l’idéal pour allumer une cheminée ?) ; la postière n’a pas le temps de parler littérature.
Quand je fais mes paiements chez le «géant jaune», je prend un ticket d’attente, soupire, puis ouvre au hasard cette même petite cinquantaine de livres à gros tirages (l’idéal pour allumer une cheminée ?) ; la postière n’a pas le temps de parler littérature.Quand j’ai voulu passer à la libraire des Yeux Fertiles, à Lausanne, je me suis souvenu qu’elle avait dû fermer en décembre dernier. Tout comme, peu avant, l’historique librairie Descombes à Genève.
Restent alors les onze branches romandes du groupe français Lagardère (Payot), les quatre tentacules, bientôt pilotées depuis la France, qui ont fait disparaître la moitié des librairies indépendantes entre 2000 et 2004 (FNAC), une amazone numérique et sa liseuse (des acheteurs qui viennent repérer des livres en librairies pour les commander ensuite sur internet, un tiers moins cher) et les derniers libraires indépendants.
Une dernière volonté ? Foncer chez l’un de ces irréductibles libraires, emmener tout ce que mon entourage compte d’enfants pour leur montrer ce que l’on appelait jadis «librairie», qu’ils ouvrent au hasard des livres sur les rayons, qu’ils bavardent avec ce que l’on appelait «libraire», histoire qu’ils puissent raconter cela à leurs enfants…
D’accord, j’exagère.
Et cette votation ne va pas radicalement changer la donne. Mais un «oui» massif donnerait un signal fort: le livre n’est pas un produit comme les autres.
Si cette loi vise l’aspect économique (fin des prix cassés dans les grandes surfaces, réduction du prix des livres importés, limitation des marges des diffuseurs étrangers) et juridique (la France, l’Allemagne et l’Autriche bénéficient déjà d’une loi semblable), elle est avant tout culturelle : maintenir la diversité de l’offre.
Que le livre ait un prix, soit, mais il a surtout une valeur. Valeur idéologique d’abord : la diversité de ses points de vue. Valeur sociale ensuite : les 3’200 artisans suisses du livre (éditeurs, correcteurs, graphistes, polygraphes, imprimeurs, relieurs). Valeur identitaire enfin : l’exception de ce pays polyglotte dont Marc Levy et Harry Potter ne sauront jamais parler.
Le 11 mars, le peuple suisse a finalement refusé (56.1%) la Loi fédérale sur la réglementation du prix du livre.
-
Esprit de Noël, es-tu là ?
Décembre, les vitrines veulent à tout prix être les premières à nous l’annoncer, cette «bonne nouvelle», du moins avant la concurrence, à grand renfort de rennes lumineux, s’il le faut, de flocons à ventouse, de…
Retour aux sources.
Bethlehem, en Cisjordanie, bientôt en Palestine libre, inch’Allah. La ville compte très peu de vitrines, assez toutefois pour que le merchandising de la Nativité s’épanouisse sous le flux de touristes tous plus ou moins pèlerins.
Dans la basilique de la Nativité, voilà une heure que j’attends (certains attendent bien depuis 2'000 ans), dilué dans une horde d’Américains qui n’ont rien de Gaspard, de Melchior, et encore moins de Balthazar. Je fais la file pour visiter la grotte de la Nativité où est incrustée une croix d’argent à 14 branches marquant l’endroit (supposé) de la naissance du Christ.
Esprit de Noël, es-tu là ? Bof. Dans la basilique, Arméniens, Orthodoxes et Catholiques se disputent le moindre centimètre carré. Un vrai partage chrétien. Ainsi, dans ladite grotte, six lanternes appartiennent aux Orthodoxes, cinq aux Arméniens et quatre aux Catholiques. Pas une de plus.
En face de la basilique, sur la place de la Crèche, un panneau propose en trois langues un «guide touristique de l’occupation». Vrai qu’en plein cœur de Bethlehem, un «mur de Sécurité» de huit mètres de haut coupe un quartier en deux et isole les grands-oncles du Christ de ses petits-cousins, les Juifs des Musulmans…
Peut-être faut-il remonter davantage le cours du temps ? À trente kilomètres de là se trouve la ville de Hébron, où Adam, Eve et Abraham seraient enterrés. Seulement voilà, deux voies distinctes mènent au tombeau de ce dernier. L’une m’est interdite, c’est celle de la synagogue (on célèbre la Sukkot). Le passage de la mosquée, lui, est ouvert. Arrivé devant le tombeau d’Abraham, j’observe des Musulmans se recueillir à quelques centimètres des Juifs. Se recueillir sur un même corps, mais venus selon deux chemins distincts, et séparés par une parois épaisse !
Dans les rues, Hébron ressemble à son tombeau. La ville n’a qu’un cœur, mais il est partagé en deux : d’un côté, un marché palestinien très animé, de l’autre, une ville fantôme abritant quelques Juifs ultra-orthodoxes, entre deux, 4’000 soldats israéliens…
Esprit de Noël, tu es las.
Alors je me demande ce qu’il y avait avant Mahomet, Jésus, Abraham, Eve et Adam. Et si c’était justement ce fameux «esprit», un paradis peuplé de rennes lumineux où tombent des flocons à ventouse ?
-
Bravo, mon cher Ashraf ! Et pardon.
Les Egyptiens raffolent des plaisanteries. Ashraf, hilare, avant même d’avoir commencé. L’histoire de deux chiens qui crient famine au Caire. L’un part tenter sa chance en Libye. Quand il revient, un an plus tard, le visage bouffi et un collier en or autour du cou, son ami s’étonne : pourquoi t’es rentré ? Et ce dernier de répondre : juste pour aboyer un bon coup ! Ashraf plié en deux.
 Au printemps 2008, j’entrais en Libye, juste avant l’affaire Hannibal (qui m’aurait fermé les portes du pays). Je me souviens. Les bakchichs de la douane de Ras al-Jedir, l’obligation d’être «escorté» par un guide officiel, les véhicules estampillés «Tourism security» qui veillaient au respect de la procédure, l’interdiction de photographier les affiches du Guide, l’interdiction même de prononcer son nom.
Au printemps 2008, j’entrais en Libye, juste avant l’affaire Hannibal (qui m’aurait fermé les portes du pays). Je me souviens. Les bakchichs de la douane de Ras al-Jedir, l’obligation d’être «escorté» par un guide officiel, les véhicules estampillés «Tourism security» qui veillaient au respect de la procédure, l’interdiction de photographier les affiches du Guide, l’interdiction même de prononcer son nom.Les Libyens ne se confiaient pas facilement à l’étranger. Je rencontrais davantage d’Africains subsahariens qui trimaient, non plus pour gagner l’Europe, mais pour rejoindre leur pays natal et fuir l’enfer libyen. Quelques Tunisiens, de petits contrebandiers. Et des meutes d’Egyptiens, souvent clandestins, toujours miséreux (à Tripoli, une charmante Lucernoise, du Haut Commissariat pour les Réfugiés, m’avait dit ses difficultés à travailler dans un pays qui n’a pas ratifié la convention… sur les réfugiés).
J’avais goûté au bon air du rif marocain, retrouvé la grâce algérienne et traversé trop vite la Tunisie : trois pays à la dictature discrète. L’autocratie libyenne avait au moins le mérite d’être claire !
J’allais vivre ensuite deux mois au Caire, où grondait la «crise du pain», où la corruption et la répression étouffaient toute velléité de changement…
Aujourd’hui, le monde arabe nous dispense une belle leçon de vie, de courage, de liberté. Le peuple est roi. Il s’agenouille encore devant Dieu - «islam», en arabe, signifie «soumission» - plus devant les tyrans !
Mais trêve d’angélisme.
Si Ashraf était là, il cesserait ses plaisanteries pour me rappeler que Ben Ali, Moubarak, Kadhafi et Bouteflika n’ont fait que poursuivre le pillage que les colons européens avaient initié. Que nos diplomaties les ont soutenus, prétextant leur lutte exemplaire contre la chimère terroriste et l’immigration devenue anxiogène. Que nous avons tous bronzé idiot, à Djerba ou à Charm el-Cheikh, sans deviner ce qui se tramait derrière le sourire crispé du petit personnel. Que nous avons dépouillé le peuple algérien de son gaz, le peuple libyen de son pétrole, dénaturé le littoral tunisien, et fait fructifier dans nos banques les 50 milliards de Moubarak.
-
Ces bulletins de vote anonymement xénophobes...
 Imagine 300 étudiants réunis dans l’aula d’un gymnase pour visionner un documentaire intitulé Au-delà des rêves (2009) : une heure de témoignages d’immigrés sénégalais venus chercher l’eldorado en Italie, en France ou en Suisse. Imagine ce documentaire projeté dans une quarantaine de villages sénégalais pour évoquer les déceptions qui attendent en Europe ceux qui veulent à tout prix se sauver en pirogues.
Imagine 300 étudiants réunis dans l’aula d’un gymnase pour visionner un documentaire intitulé Au-delà des rêves (2009) : une heure de témoignages d’immigrés sénégalais venus chercher l’eldorado en Italie, en France ou en Suisse. Imagine ce documentaire projeté dans une quarantaine de villages sénégalais pour évoquer les déceptions qui attendent en Europe ceux qui veulent à tout prix se sauver en pirogues.Sans m’attarder sur la qualité du documentaire, j’aimerais raconter ici ce qui a suivi la projection : une heure et demie de questions aux réalisateurs, lentement remplacées par un débat houleux, enfin l’intervention d’une étudiante :
- Il faut que ces gens s’intègrent. Les bons immigrés, ça va, mais ceux qui, en Suisse, s’habillent à l’africaine, comme dans votre film, ouste !
Tollé d’indignation, "facho!", huées de protestation, "raciste!", 299 étudiants se lâchent contre la camarade aux propos… courageux.
Peu importe que cette étudiante ait répété les mots de ses parents, sans les digérer. Ou que ce genre de discours s’entende dans tous les cafés du commerce. Ce qui m’a secoué, c’est la réaction de l’extrême majorité des étudiants.
Combien n’ont pas osé soutenir leur camarade ? Combien d’autruches ensablées pour combien d’humanistes en herbe ? Comment diable se fait-il que cette jeunesse-là, bientôt, se diluera dans la société frileuse qui est la nôtre? Combien d’entre eux engageront des immigrés clandestins, tout en voulant plus de souplesse en matière d'immigration ?...
Ce consensus angélique (pour employer un terme en vogue), cette autocensure bien-pensante rappellent celle qui a sévi dans les médias avant la votation des minarets. On génère de la xénophobie, en la rendant taboue. A force de servir aux jeunes du "multiculturel" à toutes les sauces, ils en ont perdu le sens. Ils ont oublié que la tolérance, c’est la capacité d’accepter... ce qu’ils désapprouvent.
"Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire", disait le philosophe. La tolérance, c’est reconnaître qu'une chose est un mal, et l’accepter, sachant que combattre ce mal engendrerait un mal plus grand encore. Ce plus grand mal, c’est une étudiante privée de liberté d'opinion. Même si cette dernière est infondée. Surtout si elle est infondée ! Car la frustration se convertira en peur, en haine. Pire, en bulletin de vote anonyme.
-
L'âme voyage à la vitesse du chameau
 Un vol Lufthansa pour Sarajevo. Un rêve jailli du siècle passé. Juste une ligne sur le panneau des départs. Ligne rouge, vol annulé. Satanée éruption du volcan Eyjafjöll, bye-bye Sarajevo.
Un vol Lufthansa pour Sarajevo. Un rêve jailli du siècle passé. Juste une ligne sur le panneau des départs. Ligne rouge, vol annulé. Satanée éruption du volcan Eyjafjöll, bye-bye Sarajevo.Ne pas perdre la face, improviser un road trip éclair en direction du sud, saluer la dent de Morcles, une pensée pour celle qui vit à Orsières, une pensée pour celui qui vit à Liddes, s'enfiler dans un tunnel, ressortir en Italie, perdre de l'altitude, traverser les rizières du Piémont, apercevoir la mer à Gênes, se baigner près de Bibonna, embarquer à Piombino, en fumer une sur le ferry et débarquer sur l'île d'Elbe.
Eyjafjöll, merci, c'est beau, un voyage au raz du sol.
Au volant, penser à celui qui n'a pu être expulsé vers le Nigeria, forcé de prolonger son exil en terre inhospitalière, en Suisse. Penser aux avocats d'affaires londoniens qui ont offert 114'000 euros à qui les amènerait à Paris en jet privé. Au fleuriste fâché de n'avoir reçu ses orchidées thaïlandaises. A la tranquillité retrouvée de la place Jemâa el-Fna, à Marrakech. Aux voisins de l'aéroport de Cointrin qui ont connu une semaine de sommeil inespéré.
Sur le ferry, lever les yeux au ciel, me laisser surprendre par une surface vierge, toute bleue, ce ciel qui n'est plus une autoroute (et regretter de n'avoir connu les dimanches sans voiture de 1973).
Sur l'île d'Elbe, promener mon index sur une carte au 1:25 000 et me souvenir d'avoir un jour rejoint Vladivostok par le rail, Kashgar par la route du Taklamakan, Kandahar en minibus public, Dubaï en ferry, Sanaa en jeep, Djibouti en barque, Addis-Abeba en train, Ngirme en dromadaire, Tamanrasset en camion. Sans ces oiseaux migrateurs de malheur. Sans avion...
Me voilà aujourd'hui au rang de ceux qui ont des «semaines de vacances». Où partir cet été? L'Indonésie? Trop touristique! Peut-être Madagascar, mais ne pleut-il pas l'été? New York? En Grèce, les prix ont chuté...
Et si... Et si on le faisait pour de bon! Un an! Un an sans avion! Comme pour se prouver qu'on n'est pas accro! Ou mieux : si on prenait le bateau pour rendre visite à ce bon vieux Eyjafjöll !
