
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que… » : avant de larguer les amarres du bonitier, toute la famille de Claude récite sa prière, en français, puis chante, en marquisien, ainsi pas besoin de gilets de sauvetage.
Il est une heure du matin et nous quittons la baie des Traîtres de Hiva Oa, l’île de Brel et de Gauguin. Nous sommes seize à bord, les uns sur les autres. La mer est démontée mais la lune rassure. Trois enfants se fabriquent un royaume de couvertures, Claude s’affale au beau milieu de l’espace vital, le fils s’endort, de puissantes basses dans ses écouteurs, et les filles roulent clopes sur clopes. La mer est démontée et la lune a disparu. Les vagues éclaboussent. L’estomac se fait fragile…

Un peu avant cinq heures, le soleil se lève enfin, Claude aussi. Il a 40 ans et s’est marié en septembre dernier, « aux Marquises, on se marie quand on est sûr ». Il vient de Ua Huka mais n’y est plus retourné depuis 18 ans, « ça sera la fête à l’arrivée ! ».
Un poisson volant me frappe l’épaule. Une vingtaine de dauphins jouent dans notre sillon. Nous dépassons Motu Tenaua, l’île aux oiseaux, et entrons dans une magnifique baie cerclée de roches volcaniques, le port de Vaipae, bienvenus à Ua Huka.
Les 600 habitants de l’île accueillent pour la première fois un festival réunissant 500 danseurs et percussionnistes venus des six îles principales de l’archipel des Marquises. Les familles dispersées dans la Polynésie se retrouvent pour l’occasion, une vingtaine de voiliers étrangers colorent la baie de Hane et une dizaine de touristes tahitiens ont fait le voyage : on n’a jamais vu ça, de mémoire d’insulaires.

Pour l’occasion, les organisateurs ont redonné vie à « Tetumu », un lieu sacré laissé à l’abandon. Un « paepae », une plate-forme en pierre, a été reconstitué pour servir de « meae », espace sacré où les Marquisiens se réunissaient pour danser au rythme des « pahu », des tambours géants de bois. Un peu d’ombre est fournie par trois « ha’e », des abris en palmes tressées reposant sur des colonnes sculptées de tek.
Toute l’île est en ébullition. Pour nourrir les festivaliers, les jeunes chassent et pêchent à outrance depuis quelques jours, cochons sauvages, chèvres, langoustes, crabes, etc. On laisse le coprah tranquille et fait des réserves de fruits, mangues, papayes, oranges, bananes, etc. On voit partout les danseuses élaborer leur costume (il a été interdit d’importer des végétaux d’autres îles par peur de la « mouche des agrumes ») et les danseurs sculpter leur casse-tête de bois (le nombre de visages représentés correspondait au nombre de victimes massacrées au combat). Les exilés tahitiens râlent de devoir consacrer leurs vacances de Noël au tressage de paniers qui serviront à cuire de la viande à l’étouffée dans des « fours marquisiens ». Petit à petit, les jeunes danseurs et danseuses des différentes îles, qui dorment les uns sur les autres dans des salles de classe, font connaissance et amèneront peut-être ainsi une solution aux problèmes de consanguinité...
 Un autre mesure préventive a été prise par le maire Nestor (on appelle ici les maires par leur prénom) : « considérant la nécessité d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité publique durant le festival de Ua Huka, la vente de boissons alcoolisées est interdite du 16 au 21 décembre ». Vrai que les Marquisiens peuvent avoir l’ivresse mauvaise. Une amende est ainsi prévue pour les contrevenants dénoncés à la Gendarmerie nationale fraichement débarquée à Ua Huka.
Un autre mesure préventive a été prise par le maire Nestor (on appelle ici les maires par leur prénom) : « considérant la nécessité d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité publique durant le festival de Ua Huka, la vente de boissons alcoolisées est interdite du 16 au 21 décembre ». Vrai que les Marquisiens peuvent avoir l’ivresse mauvaise. Une amende est ainsi prévue pour les contrevenants dénoncés à la Gendarmerie nationale fraichement débarquée à Ua Huka.
On se rend au « Tetumu » en autostop. La première voiture s’arrête toujours, c’est ainsi depuis une semaine. Je partage la plateforme du pick-up avec un jeune et son costume soigneusement plié dans une caisse à linges. Il semble avoir davantage l’appréhension de la première que la rage du guerrier. On dépasse quelques marginaux venus à cheval mais l’extrême majorité ne jure plus que par le dieu Toyota.
Sur un parking improvisé, on surprend des danseurs en train de fumer une pipe de cannabis avant les représentations pour se mettre dans l’esprit. A quelques pas, une danseuse de Hiva Oa, arrivée le matin même par une mer agitée, vomit ses trippes... Autour d’eux s’agite un journaliste de Tahiti qui se plaint des réponses monosyllabiques des Marquisiens...
Le festival débute. Par une prière œcuménique. Les Marquisiens sont à 95% catholiques. Puis viennent les hymnes : le marquisien, que tout le monde entonne à tue-tête, le polynésien, dont certains se souviennent des paroles, et puis « La Marseillaise » : il faut bien faire honneur au Haut-Commissaire de la République qui a fait le déplacement et subventionné généreusement les festivités. Il faut même applaudir son discours qui se conclut par un tonitruant « vive la France ! ».
Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. D’abord le rythme. Une vingtaine de percussionnistes qui s’usent les mains sur des peaux de chèvres. Cela prend rapidement beaucoup d'ampleur.
Une cinquantaine de danseurs envahissent ensuite le « paepae », emmenés par le « tuhuka », le maître du savoir. Majestueux.
 Les six délégations se succèdent, des heures durant. La tradition impose quelques figures, comme le « Putu » avec lequel les hommes souhaitent la bienvenue, ou le « Ruu » que les femmes dansent à genoux dans le but de calmer les esprits, mais pour le reste, chaque délégation est libre de traiter ses thèmes et raconter ses légendes comme bon lui semble.
Les six délégations se succèdent, des heures durant. La tradition impose quelques figures, comme le « Putu » avec lequel les hommes souhaitent la bienvenue, ou le « Ruu » que les femmes dansent à genoux dans le but de calmer les esprits, mais pour le reste, chaque délégation est libre de traiter ses thèmes et raconter ses légendes comme bon lui semble.
 Les nouvelles générations mettent l’accent sur le « Haka Toua », une impressionnante danse de guerriers que les jeunes exécutent avec une jubilation jouissive, encouragés par les cris des danseuses, alors cantonnées au rôle de spectatrices. Après ce « Haka », le sol est recrépi de morceaux de costume.
Les nouvelles générations mettent l’accent sur le « Haka Toua », une impressionnante danse de guerriers que les jeunes exécutent avec une jubilation jouissive, encouragés par les cris des danseuses, alors cantonnées au rôle de spectatrices. Après ce « Haka », le sol est recrépi de morceaux de costume.
Autre incontournable, la danse de l’oiseau, « Haka Manu », toute en grâce et en douceur, qui met en évidence une danseuse soliste. Nuku Hiva lui préfère le « Maha’u », la danse du cochon, réservée aux hommes, qui fut interdite jadis par les missionnaires à cause de ses connotations érotiques et du râle particulier émis par les danseurs.
Tahuata est la seule île à faire la danse de la pieuvre durant laquelle les femmes anéantissent un à un les hommes. Hiva Oa se distingue pas la qualité de ses costumes. Nuku Hiva vient offrir aux organisateurs un tambour sculpté de plus de trois mètres de haut. Fatu Hiva organise un « tir à la branche » entre ses danseurs et les chefs des autres délégations. Ua Pou fait virevolter des torches enflammées. Ua Huka invite symboliquement un cavalier dans sa chorégraphie…

Durant les danses, les étrangers sont patients, attentifs, émus par l’enthousiasme des enfants, la fierté des pères et la sérénité des femmes. Ils photographient, en noir et blanc de préférence, filment en gros plans, s’improvisent ethnologues et s’appliquent à faire disparaître toute trace de pick-up ou de téléphones portables. Ils aimeraient ne pas entendre la tronçonneuse qui sculpte à proximité une pirogue, ou la meuleuse qui polit un tiki de pierre. Ni entendre un commentateur bilingue lancer : « on vous demande d’applaudir ce chant magnifique dans la plus pure tradition marquisienne ».
Les étrangers aimeraient avoir gommé l’ère des missionnaires et retrouver des tribus cannibales qui s’affrontent sur les hauts plateaux : une société de guerriers sanguinaires et de femmes lascives. En fait, ils sont émus par ce que leurs ancêtres - explorateurs, missionnaires, colons, puis exploitants - ont détruit scrupuleusement...
« Je comprends alors la passion, la folie, la duperie des récits de voyage. Ils apportent l’illusion de ce qui n’existe plus et qui devrait être encore, pour que nous échappions à l’accablante évidence que 20'000 ans d’histoire sont joués. »
Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 1955 (!).
Le public marquisien, lui, n’hésite pas à rire à gorge déployée lorsqu’un costume glisse et laisse apparaître un caleçon Calvin Klein peu ragoutant. Ils filment vaguement, rient des imprécisions et se moquent des gestes maniérés des « hommes-danseuses ». Les Marquisiens ne se prennent pas au sérieux. Pourtant, ce festival est la victoire de tout un peuple. Dans les années 30, ils ont failli disparaître à cause des maladies et de l’alcool, importés par les étrangers. En 1980, les enfants se faisaient encore battre s’ils parlaient leur langue à l’école…
Aujourd’hui, les Marquisiens, moins de 10'000 âmes, ont su se refaire une santé identitaire : des danses, des chants, une langue, un artisanat, une mythologie, des costumes, des rythmes et une certaine joie de vivre.
 Lagon turquoise et palmiers émeraude. La baie de la Jalousie, au sud-ouest de l’île de Sainte-Lucie, dans les Petites Antilles, est un croissant de sable blanc bordé de deux aiguilles volcaniques, le Gros Piton et le Petit Piton, deux merveilles culminant à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer des Caraïbes.
Lagon turquoise et palmiers émeraude. La baie de la Jalousie, au sud-ouest de l’île de Sainte-Lucie, dans les Petites Antilles, est un croissant de sable blanc bordé de deux aiguilles volcaniques, le Gros Piton et le Petit Piton, deux merveilles culminant à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer des Caraïbes. A midi, faisant l’ascension du Gros Piton, la sueur avait su mettre du sel dans nos vies.
A midi, faisant l’ascension du Gros Piton, la sueur avait su mettre du sel dans nos vies.








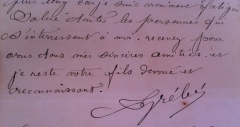

 Chapeau de paille, chemise et pantalons blancs. Stylo glissé sous le bracelet de sa montre. Brel ne fume plus depuis deux ans, il a pris un peu de ventre.
Chapeau de paille, chemise et pantalons blancs. Stylo glissé sous le bracelet de sa montre. Brel ne fume plus depuis deux ans, il a pris un peu de ventre.







 Corinne Desazens ira à Vlčnov, en Moravie du Nord, près de la Slovaquie, où se situe l’intrigue de La belle de Joza de Kveta Legatova.
Corinne Desazens ira à Vlčnov, en Moravie du Nord, près de la Slovaquie, où se situe l’intrigue de La belle de Joza de Kveta Legatova. 