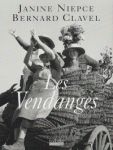 En quête de témoignages sur les vendanges de jadis, je tombe sur un ouvrage illustré de Bernard Clavel, tiens…
En quête de témoignages sur les vendanges de jadis, je tombe sur un ouvrage illustré de Bernard Clavel, tiens…
… ce nom... oui ! En 1981, l’écrivain français Bernard Clavel posait ses valises à Morges. Un séjour de quatre années assez marquant pour qu’il choisisse plus tard de déposer toutes ses archives à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.
Livre phare de sa bibliographie, Les fruits de l’hiver raconte la tragédie ordinaire de parents âgés, sous l’Occupation, sans nouvelle de leur fils résistant. Prix Goncourt 1968 !
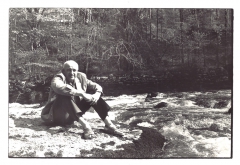 A Morges, il écrit La lumière du lac, un roman retraçant l’histoire des migrants francs-comtois ayant dû fuir la peste et la guerre en 1639. Ils s’en vont à pied, affrontent la neige, la faim, les loups. L’espoir est grand, passant la frontière suisse et arrivant sur les rives du lac Léman, de trouver enfin un havre de paix. A Morges pourtant, ils ne sont pas les bienvenus. On les parque dans un village isolé où ils tentent tant bien que mal de recommencer une nouvelle existence...
A Morges, il écrit La lumière du lac, un roman retraçant l’histoire des migrants francs-comtois ayant dû fuir la peste et la guerre en 1639. Ils s’en vont à pied, affrontent la neige, la faim, les loups. L’espoir est grand, passant la frontière suisse et arrivant sur les rives du lac Léman, de trouver enfin un havre de paix. A Morges pourtant, ils ne sont pas les bienvenus. On les parque dans un village isolé où ils tentent tant bien que mal de recommencer une nouvelle existence...
Détachons-nous de la honte de ce très lointain passé… et revenons à nos Vendanges !
Clavel a 16 ans en 1939, il récolte le raisin dans son Revermont natal : « Il faut croire que la vigne est dotée d’une force secrète, car dès les premiers jours, en dépit de la fatigue, de la souffrance, je me suis mis à l’aimer ».
Il convainc très vite le vigneron de l’engager pour l’année. Il frotte l’intérieur des tonneaux, bûcheronne, taille des échalas, soigne la jument, arrache, laboure, plante, taille, effeuille : « Jamais encore n’avais-je autant regardé la terre et ce qu’elle porte de beauté ».
Bernard Clavel décrit une époque où, avant les saints de glace, des hommes se relayaient pour veiller la nuit, et sonner les cloches de l’église en cas de gel ; on conservait alors les sarments dans les vignes pour pouvoir rapidement leur bouter le feu...
A la fin du livre, une phrase anodine me bouscule et laisse comme un goût de vinaigre : « Je n’avais jamais le temps de lire car, le soir, la fatigue m’écrasait avant même que je m’écroule dans mon lit ; une poésie entrait en moi qui n’avait pas grand-chose en commun avec celles que je trouvais dans les livres. »









